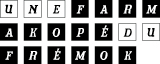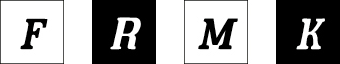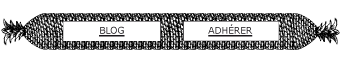Souvenir d’une journée parfaite — épuisé
48 pages — 24 × 26,5 cm
saltotypie — couverture souple
avec jaquette
collection Récits de Ville, #5
ISBN 2-930204-35-4
16 €
Entretien avec Dominique Goblet : réalité de la fiction
par Pierre Polomé, Bruxelles, juillet 2001
Votre livre est né d’abord de votre participation à l’Atelier de l’Echangeur Narratif. Comment s’est déroulée pour vous cette expérience ?
Il avait été question, chez Fréon, que je participe à l’Atelier. Puis, les groupes se sont formés. Mais il y a toujours ce rapport particulier qui m’unit aux éditeurs Fréon, qui est un rapport, je pense, de grande admiration partagée. Je suppose qu’ils pensent du bien de mon travail, sans quoi ils ne l’auraient pas soutenu. En même temps, nous avons une belle relation d’amitié mêlée de divergences d’opinions, de comportements, des incompréhensions… Je ne sais pas exactement mais certaines choses ont fait qu’il y a eu des tensions évidentes. Ma parano galopante joue aussi son rôle là-dedans. Mais je crois qu’il y a un désir de travailler ensemble, de part et d’autre, et en même temps un désir de séparation, réciproque également. C’est bizarre.
A quel atelier avez-vous participé ?
Le dernier, celui de septembre, avec notamment Frédéric Coché. Au début, je suis allée travailler à l’atelier, avec toujours cette relation difficile dont je parlais. Or, j’étais habituée à travailler seule chez moi depuis des mois. J’ai décidé de reprendre le travail chez moi, ce qui m’a fait économiser aussi des temps de trajets et éviter des tensions. De plus, je n’avais pas besoin de "m’immerger" dans Bruxelles comme d’autres auteurs qui n’habitaient pas la ville.
Ces conditions particulières de travail ont-elles influencé la création du récit ?
Oui, dans le sens où cela m’a rendue très indépendante. A part cela, je piétinais au début pour construire le scénario. J’en ai parlé à Thierry Van Hasselt qui m’a aiguillée sur quelques pistes dont j’ai profité. Les 8/10èmes du livre ont été réalisés chez moi et le fait est que, à un moment donné, je leur ai apporté toute l’histoire terminée. A ce moment, ils en ont découvert l’ensemble.
Les Ateliers de l’Echangeur narratif ont donné tantôt des courts récits et tantôt des "albums" en soi. A quel moment avez-vous choisi de réaliser une histoire plus longue, un véritable livre en soi ?
C’est à nouveau Thierry Van Hasselt qui, voyant les quinze - ou plus ? je ne sais plus - pages que j’avais dessinées, m’a proposé d’en rajouter quelques-unes pour en arriver à un livre. J’ai répondu, "Oui, pas de problème !". De fil en aiguille, le récit s’est donc allongé.
On retrouve dans cette histoire votre tendance à l’autobiographie.
Oui, une fois de plus dans mon approche personnelle, le récit a tenté de se distancier d’un rapport autobiographique, ce qui l’en a en fait rapproché. Je ne crois pas que j’arrive à faire franchement de la fiction. Si je fais de la fiction, celle-ci est toujours très nourrie de choses vues et entendues. Très rarement, j’écris de pures inventions. Dans le cas de ce récit, c’est un vrai chassé-croisé d’une chose qui se voudrait une fiction et qui devient une autobiographie et d’une chose qui se voudrait autobiographie et qui devient le récit fictionnel. C’est la première fois que je travaille comme cela. Moi qui recherche actuellement la simplicité dans mes récits, ce n’est pas vraiment le cas ici.
Qu’entendez-vous par
"simplicité" dans le récit ? Sous quelle forme ?
Prenez par exemple Reprends ta saloperie, un récit paru dans Frigobox 09 qui a marqué pour moi un tournant au niveau de la recherche technique, bien que le scénario présente des faiblesses. C’est une histoire vécue, plus ou moins autobiographique, sans doute plus difficile à raconter qu’un récit de fiction parce qu’en le créant, j’y suis terriblement immergée. Je n’imagine pas le regard des autres quand je réalise ce type d’histoire. C’est à ce niveau, celui de la compréhension du scénario, que je me rapproche d’une recherche "linéaire", basée sur le passé de la bande dessinée. Je suis d’ailleurs contente d’avoir travaillé avec l’Association et ses auteurs au passé souvent très "bédéphile". Devoir travailler de la façon la plus limpide est une contrainte magnifique. Il faut raconter des choses plus ou moins fortes de façon limpide. J’en suis arrivée ensuite à réaliser ce récit paru dans Frigobox 10 et qui est une parodie du Château (paru dans Frigobox avant d'être publié en un ouvrage en 2002, ndlr) de Franz Kafka adapté par Olivier Deprez. Je manquais de temps mais à nouveau, j’ai tenté de donner une version moderne très très claire.
Il y a aussi des dangers à vouloir être trop limpide…
Effectivement. Je ne veux pas, par exemple, tomber dans le style "manga", cette bande dessinée qui me tombe des mains et que j’ai un mal fou à lire, même les mangas que l’on m’indique comme "bons". Par contre, je trouve qu’il y a quelque chose de très contemporain dans l’idée d’une décodification ; finalement, travailler autour d’une lecture très rapide est également poser une critique sur notre société de consommation. Aujourd’hui, on ne prend plus le temps de lire ou d’écouter. Par contre, on s’informe pour savoir ce qu’il faut pouvoir dire sur Proust ou on lit les Inrocks pour pouvoir parler musique. La culture devient trop large que pour qu’on puisse encore avoir le temps de se faire une culture.
A propos de l’Association et d’autobiographie, je crois que vous aviez commencé un long récit autour de vos parents…
Ce projet reste dans mes tiroirs pour l’instant. Il existe à peu près 25 planches. Je ne m’en suis pas aperçue tout de suite mais, "comme par hasard", l’unique case de la toute dernière planche que j’ai attaquée est aussi la première sur laquelle on voit ma mère. Depuis lors, je n’arrive plus à travailler. Ce n’est même pas une question d’envie de continuer ou non, car beaucoup d’idées me viennent. En fait, cette histoire tourne autour d’un récit en particulier sur lequel peuvent se greffer beaucoup de choses. Mais je n’y arrive plus.
Pourquoi l’action de Souvenir d’une journée parfaite commence-t-elle dans un cimetière ?
Je voulais que les choses partent de là, en l’occurrence le cimetière d’Uccle qui est en vérité le cimetière de Saint-Gilles. Mon père y a été enterré. J’y avais été quelque temps auparavant en espérant retrouver le nom de mon père. J’avais rencontré les gardiens du cimetière, des gens inimaginables qui ont manifestement beaucoup de choses à raconter. Par exemple, des histoires de querelles durant un enterrement et des individus discutant l’héritage avant même que le cercueil ne soit descendu en terre. Et mille autres choses hallucinantes, soit dit en passant.
Le choix d’un cimetière dans le cadre d’un Récit de ville (prétexte à l’existence de l’Atelier de l’Echangeur Narratif) a de quoi surprendre…
Je m’étais dit qu’un récit autour de la ville devait considérer la ville comme un dispersement au sein d’une forme de rassemblement. Finalement, le cimetière représente le rassemblement de la ville. Les gens habitent à divers endroits de la ville et se retrouvent tous au cimetière. C’est une ville dans la ville, avec ses rues, ses avenues, ses allées et ses adresses. Les endroits où les gens finissent me semblent représenter au mieux les villes.
Pour reprendre mon récit, j’avais donc tenté de retrouver le nom de mon père, sans succès. J’y suis retournée une deuxième fois quand j’ai commencé le récit. Là, j’ai lu à voix haute, sans personne aux alentours, les noms de tous les gens qui avaient été incinérés. Il y avait une vingtaine de stèles et 130 noms inscrits sur chacune d’elles. Cela créait un rythme lancinant, tous ces noms désinvestis prononcés à voix haute. Qui nomme encore ces gens ? Qui leur donne encore ne fut-ce qu’une vie vocale ? Le sentiment était étrange.
Il y a des noms sur lesquels on s’arrête, on ne sait pourquoi, un nom qui me touche, que j’aime bien, un double nom amusant. Un père et son fils, et leurs dates. Immanquablement, l’imagination travaille sur ces noms qui ressortent. Comment sont-ils morts ? Pour quelle raison ? Et leur vie : quelles joies, quelles disputes ?
C’est de là que vous êtes partie pour imaginer l’existence d’un de ces noms ?
C’était l’idée : partir de cette recherche du nom de mon père, arriver à un nom réel qui m’entraîne sur une fiction. Qu’a pu vivre cette personne, dans ce cas un homme du nom de Mathias Khan ? Voilà, on part dans ce récit fictionnel, celui-ci étant coupé régulièrement de vues réelles du cimetière lors de ma quête. Et des réflexions que j’ai eues à ce moment-là.
Je voulais mêler les deux niveaux sans trop savoir comment, et c’est là que Thierry van Hasselt m’a aidé. Toutes les scènes de cimetière, dessinées de façon très réaliste, sans personnages, sont des scènes purement autobiographiques. Toutes les scènes qui partent dans le personnage sont une fiction. Mais la vérité, c’est que c’est une fiction uniquement nourrie par ma vie. De fait, plus on essaye d’imaginer un personnage, plus on ne fait que projeter sa propre réalité. A fortiori quand on pense à une personne morte dont le nom est gravé sur une stèle, on peut l’imaginer accomplir telle ou telle action mais on ne peut imaginer ces choses que par rapport à ce que soi-même on a vécu, forcément. En vérité, la vie de ce personnage est la mienne.
D’ailleurs, quand je lis un récit autobiographique, je me demande toujours jusqu’à quel point ce que je lis est "juste", quelles sont les inventions dans cette histoire ? Mais rarement on ne se pose cette question face à une fiction, tellement le récit fictionnel ressemble à la réalité. Ce problème m’intéressait, l’idée selon laquelle faire une fiction n’est encore que re-produire sa propre réalité. Mon récit est un dès lors un croisement d’une fiction qui n’est en fait que la réalité avec la réalité qui n’est elle-même pas grand-chose.
Vous employez souvent des techniques mixtes, collages, bics, etc… Comment avez-vous travaillé
dans ce cas-ci sur le plan technique ?
Il s’agissait de noir et blanc. J’ai donc choisi un crayon noir assez gras, que je mélange parfois avec de la graisse pour créer des " salissures ". Ce gras donne au crayon une autre intensité et crée des gris et des jaunes, résultat du vieillissement du gras sur le papier. Il est possible que ce livre sorte en bichromie, ce serait heureux en tout cas.
Cette technique est-elle liée au sujet du récit ou gardez-vous à ce niveau un espace pour l’intuition ?
On peut y trouver un rapport de "traces", entre les univers, mais bon, il est clair que je n’allais pas travailler une histoire de ce type avec des aquarelles. Ce n’est pas non plus de la mine de plomb. Ici, il y a un noir "noir" et des vrais blancs, entretenant des rapports incisifs. Le gras garde l’idée de trace. Je ne me suis pas posée longtemps cette question du matériau ; j’ai plutôt essayé de trouver un matériau dans lequel je n’aille pas franchement dans les jeux de matière… Mais dans lequel il y a quand même un peu de dépôt, de "glissement".